Guillaume Laget, photos de montagne
Photographe des Alpes, en particulier les massifs autour de Grenoble de la Chartreuse au Vercors, des Écrins et au Dévoluy !
Retrouvez mes actualités sur mon site et en particulier les photos de la semaine http://www.tetras.org/Menu.html, sur Facebook sur Twitter sur Mastodon sur Insta

Traversée Nord-Sud des arêtes du Néron
Après la montée par le couloir en Z mercredi, nouvelle ascension du Néron jeudi, cette fois-ci pour une traversée des arêtes.
La chaleur me fait préférer la montée par le bus TAG 55 au col de Clémencières plutôt que la marche. Arrivée au col 17h, horaire parfait en cette saison !
Parfaite aussi, l’ambiance des derniers rayons sur ce versant, et sur les arbres en fleurs !

Montée par le couloir de Clémencières, dont l’accès est bien encombré d’arbres tombés récemment pour certains. Arrivée sur les arêtes en environ 1h30 pour ce point de vue sur le sommet Nord.

Du sommet Nord, traversée un peu acrobatique pour rejoindre le sommet Sud, vue des deux côtés :





Le passage de l’Avalanche, assez étroit, avec au bout une vieille croix branlante :





Dernier rayon de soleil à la descente de la rampe (impressionnante mais pas très difficile) juste à l’arrivée du couloir en Z…et retour par le même itinéraire que la veille.

Couloir en Z, et traversée, au Néron
Semaine de mi-avril très chaude, et neige abondante en moyenne montagne, sans regel nocturne : le Néron, qui ne dépasse pas 1300m, est une bonne destination.
Et le couloir en Z m’intrigue depuis quelques temps : pas de topo avec photo trouvable sur internet, et surtout des messages « risque d’éboulement », « désormais à éviter »…mais sans raison précise (le gros éboulement de 2011 bien visible de Grenoble concerne le couloir Godefroy, bien plus au Nord).
Donc mercredi en fin d’après-midi, c’est parti !
Comme d’habitude, vélo laissé dans la partie basse de Saint-Martin-le-Vinoux, montée rapide entre routes rue et sentiers jusqu’au hameau de Narbonne, puis direction les Quatre Chemins. Le sentier balisé de bleu tout du long remonte en forêt et se rapproche des falaises qu’il longe longuement. Et le départ du couloir est impossible à manquer : un large couloir-rampe terreux, avec un Z sur un gros caillou, qui repart en arrière (vers le Sud).


En haut de cette rampe, un mur équipé d’un câble (qui semble encore solide bien qu’un peu rouillé : je ne garantis pas son état dans le futur proche…) permet de continuer encore un peu en ascension vers le Sud, jusqu’à buter contre la partie supérieure de la falaise.

C’est alors que le sentier (toujours balisé de bleu) repart, en traversant un couloir, puis collé à la falaise sur une vire étroite mais boisée « côté vide ».


On arrive vite sous la pointe où l’itinéraire va rejoindre les arêtes. Une cinquantaine de mètres et c’est fait !


Ne reste plus qu’à redescendre par le Sud via le Lucky Luke et la passerelle Hippolye Müller.



Ne reste plus qu’à redescendre par le Sud via le Lucky Luke et la passerelle Hippolye Müller.


Entropia, Samuel Alexander
Une journée de voyage en train entre Alpes et Cévennes m’a enfin permis il y a quelques jours de me plonger dans le livre « Entropia » de Samuel Alexander.
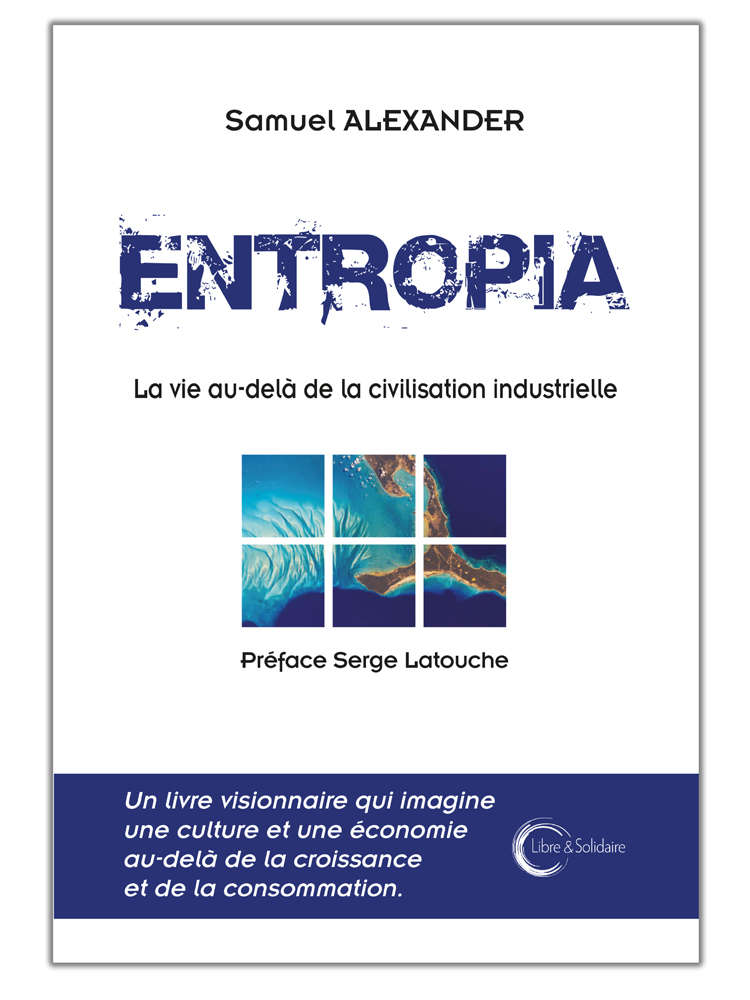
Il m’avait été offert il y a quelques mois par un ami qui en est le traducteur français, Guillaume Dutilleux.
Le sujet du livre est la description d’une expérience de vie, après l’effondrement de la civilisation industrielle.
Entre roman et essai, cette « Utopie » décrit les succès et difficultés d’une vie non basée sur l’exploitation de ressources non renouvelables…
Parmi les thèmes, des plus terre-à-terre aux plus fondamentaux, plusieurs font échos à des débats actuels sur Grenoble et en France :
- toilettes sèches « à une époque où l’eau douce se fait plus rare, la vieille tradition d’envoyer les déjections humaines dans l’eau potable nous semble maintenant non seulement étrange mais aberrante »
- habitations en dur « les indiens auraient-ils été avisés d’abandonner les wigwams en échange de 40 ans de labeur pour un logement plus « civilisé » ? La rationalité économique de ce choix serait douteuse, en effet. »
- démocratie participative, tirés au sort et experts…
- revenu universel,
- nature en ville « arroser les graines de produits chimiques afin de préserver une apparence luxueuse, en ville comme en banlieue, dans l’espoir que la nature ne ferait pas irruption dans la propreté impeccable de la vie civilisée »
- contrôle des naissances « pour garantir les libertés du futur nous avons dû restreindre les libertés du présent »,
- respect des lois et règles « tout ce que nous pouvons faire est de publier la loi comme une règle acceptée démocratiquement, expliquer clairement son principe, et croire en l’avènement d’une culture qui le respecte »
… et sans prétendre que l’expérience aboutisse à la perfection bien sûr « une société dans laquelle il n’y aurait aucun désaccord ou conflit ne serait pas une société humaine – et même si une telle société devait voir le jour, elle risquerait d’être terriblement ennuyeuse »
Pour ne rien gâcher, la première partie du livre, avant un rebondissement dans l’histoire, s’achève par l’ascension en solitaire d’un sommet…et un lever de soleil.
« la sérénité dans la vie demande une pratique régulière de la solitude »
![17_12_Habert_Chamechaude_07 [ref.]](https://guillaumelaget.files.wordpress.com/2018/01/s_17_12_habert_chamechaude_07.jpg)
Je n’ai pas le talent ni de faire une analyse littéraire, ni une analyse technique du livre, qui n’est pas exempt de défauts…je vous invite à vous faire une idée par vous même !
Un commentaire par son auteur :
Pour le commander, privilégiez le site de l’éditeur ou vos libraires locaux.
Je peux aussi le prêter aux grenoblois…
Un an et quelques sans MA voiture : bilan
En septembre 2016 j’avais profité d’une opération « Sans Ma Voiture » organisée à Grenoble pour décider, dès novembre, de revendre ma voiture pour n’avoir plus de véhicule personnel. J’ai déjà raconté ici l’expérience :
Le changement ne concernait pas tant la vie quotidienne et les trajets domicile-travail – déjà principalement à vélo – mais l’accès à la montagne, que j’allais principalement effectuer avec l’autopartage profité par Citélib/Citiz.
Plus d’un an plus tard il est temps de faire le bilan…
* D’octobre 2016 à septembre 2017 j’ai parcouru 4850km avec Citiz, pour un montant tout compris (abonnement, trajet, essence, assurance, place de stationnement réservé, entretien, etc…) de 2200 euros, soit 45 centimes du kilomètre. De janvier à décembre 2017 chiffres comparables (2400€ pour 5400km).
Il faut rajouter à cela environ 15% d’utilisation de voiture empruntées ou louées à d’autres particuliers famille amis, seul ou en co-voiturage.
Au bilan, cela me semble tout à fait valable par rapport à l’acquisition-entretien d »une voiture neuve, pour faire dans les 5000km par an.
![16_10_Dome_De_Bellefont_13 [ref.]](https://guillaumelaget.files.wordpress.com/2018/01/s_16_10_dome_de_bellefont_13.jpg)
En pratique je n’ai jamais rencontré de gros problème avec Citiz : toujours une voiture disponible à quelques centaines de mètres et au pire du pire 2km, en ne réservant que quelques minutes avant le plus souvent.
Au chapitre des petits ratés : une voiture introuvable une fois, une en panne, à chaque fois remplacée rapidement par un appel à la centrale.
Une fois des pneus neige manquants, début novembre.
* Pour les longs trajets, pour aller retrouver de la famille et des amis ayant une voiture sur place : le train ! Vers Gap, Saint-Crépin, Avignon, le Gard.
Je n’ai pas testé la possibilité d’utiliser des voitures Citiz partout en France, ni de voiture de location.
* Un effet notable de payer diretement chaque trajet (plutôt qu’un gros montant à l’achat de la voiture ou annuel – assurance, entretien, …) est que j’ai eu tendance à réduire les distances dans le choix des randonnées, à parfois tenter le vélo (col de Porte), la marche (Néron depuis Saint-Martin-le-Vinoux), vélo + train pour Lus-la-Croix-Haute…
![a [ref.]](https://guillaumelaget.files.wordpress.com/2018/01/s_a.jpg)
ou à préférer aller marcher directement à pieds depuis Grenoble plutôt qu’en « vraie » montagne.
Sans avoir l’impression de me priver en terme d’effort physique ou de photographies.
Bref, une expérience totalement concluante.
Prochaine étape peut-être : le vélo électrique pour l’accès aux points de départ de randonnées à moins de 30-40km de Grenoble…?
Commentaires récents